Veille jurisprudentielle : bioéthique, divorce, filiation/nationalité, Succession/libéralité
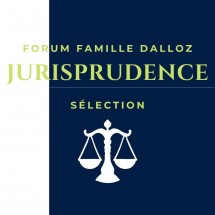 Voici les quelques décisions collectées la semaine dernière :
Voici les quelques décisions collectées la semaine dernière :
- Bioéthique/droit pénal
- Divorce
- Filiation/nationalité
- Succession
- Bioéthique/Droit pénal
La peine d’emprisonnement avec sursis infligée à une militante Femen ayant manifesté, poitrine dénudée, dans une église pour défendre le droit à l’avortement constitue une violation de l’article 10 de la Convention (Arrêt Bouton c/ France, requête n°22636/19).
- Divorce
Blocage de la procédure de divorce lorsque le demandeur ne conclut pas et désistement du demandeur (TJ Amiens, 26 sept. 2022, n° 21/01565) – Sur le fondement des articles 395 et 1107, dernier alinéa, du code de procédure civile un juge de la mise en état, confronté au silence d’un demandeur au divorce qui n’a jamais conclu au fond et à l’initiative d’un défendeur qui a cru pouvoir le faire à sa place, donne finalement acte au demandeur de son désistement.
NB – Jérôme Casey vous livrera son analyse critique de l’ordonnance de désistement dans le numéro de novembre de la revue AJ famille. En attendant, je vous invite à lire son article publié au mois d’octobre dans le dossier “Divorce : l’heure du bilan” (AJ fam. 2022. 473. – pour la version pdf, cliquer ICI).
- Filiation/nationalité
Différence de traitement entre les personnes nées, avant et après l’indépendance de l’Algérie, en France métropolitaine des mêmes parents (CEDH, 13 oct. 2022, Zeggai c/ France, n° 12456/19) – La distinction des modalités d’accès à la nationalité française selon que les personnes nées en France, de parents d’origine algérienne nés français, sont nées avant ou après l’indépendance de l’Algérie ne constitue pas une violation de l’article 14 de la Convention.
NB – Selon le communiqué de presse de la CEDH, « l’affaire concerne le rejet de la demande de certificat de nationalité française déposée par le requérant, né en France avant l’indépendance de l’Algérie, de parents qui étaient alors Français, qui a vécu continument en France, et dont les frères et soeurs, nés en France après l’indépendance de l’Algérie, sont Français. Le requérant qui avait été titulaire d’une carte d’identité française et d’une carte d’électeur, délivrées par erreur par l’administration française, invoquait devant la Cour avoir fait l’objet d’une discrimination prohibée.
Après avoir relevé que les parents du requérant, nés sur le territoire français d’Algérie et de statut civil de droit local, n’avaient pas usé de la possibilité qui leur était ouverte de se faire reconnaître la nationalité française en souscrivant une déclaration de reconnaissance, la Cour précise qu’elle ne voyait pas de raison de douter que la distinction opérée entre les enfants mineurs de personnes qui relevaient du statut civil de droit local selon la date de leur naissance, avant ou après l’accession de l’Algérie à l’indépendance, était à l’époque en adéquation avec le but légitime poursuivi, à savoir que les enfants mineurs suivent la condition de leurs parents au regard de la nationalité française, dès lors que la question du maintien de leurs parents dans la nationalité française se posait précisément en raison et dans le contexte de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
La Cour relève ensuite que la différence de traitement entre le requérant et ses frères et soeurs ne porte pas sur le principe même de l’accès à la nationalité française mais sur les modalités de l’accès à celle-ci. Tout en soulignant que l’État défendeur a commis une erreur en délivrant une carte d’identité et une carte électorale à une personne qui n’avait plus la nationalité française, elle précise que cette circonstance est sans incidence sur la question soumise à l’examen de la Cour, relative au caractère discriminatoire ou non de la différence de traitement dénoncée par le requérant.
Compte tenu de la large marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur, la Cour admet que les moyens employés étaient proportionnés au but légitime visé. Elle en conclut que la différence de traitement dénoncée par le requérant, dans la jouissance du droit au respect de la vie privée, repose donc sur une justification objective et raisonnable.
- Succession
Annulation d’un testament mystique qui ne peut non plus valoir comme testament international (Civ. 1re, 12 oct. 2022, n° 21-11.408, 728 FS-B) – Aux termes de l’article 978 du code civil, ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique.
En l’occurrence, une cour d’appel a relevé que, dans l’acte de suscription de 2014, le notaire avait mentionné que le testament mystique litigieux lui avait été remis par « le testateur », qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu’« il » en avait effectuée. Elle a retenu qu’il ressortait du dossier de tutelle de la défunte et des pièces médicales produites que celle-ci, qui souffrait de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson, était dans l’incapacité de lire elle-même le texte dactylographié sur le document présenté et qu’aucun élément intrinsèque ou extrinsèque, dont l’acte de suscription, ne venait l’éclairer sur la manière dont l’intéressée aurait pu lire le document qu’elle présentait comme son testament.
C’est donc sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de caractériser l’impossibilité absolue de la défunte de lire le document, en a déduit, en l’absence de certitude sur l’expression de ses dernières volontés, que l’acte devait être annulé. Un acte qui ne pouvait pas non plus valoir comme testament international : la défunte étant dans l’incapacité de lire le document remis au notaire, de sorte qu’elle n’avait pas été en mesure de déclarer que ce document était son testament et qu’elle en connaissait le contenu, le document présenté, déclaré nul en tant que testament mystique, ne pouvait valoir comme testament international.
Acceptation de la succession à concurrence de l’actif net et absence de déclaration des créances des créanciers (Civ. 1re, 12 oct. 2022, n° 20-21.016, 729 FS-B) – Les paiements effectués en vertu du jugement exécutoire par provision éteignent les créances correspondantes des locataires, de sorte que ceux-ci n’étaient pas soumis à l’obligation de les déclarer à la succession de leur bailleur.
En l’occurrence un jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a notamment condamné la défunte à faire réaliser des travaux et à payer mensuellement à ses locataires des indemnités de jouissance. La bailleresse, qui avait interjeté appel, est décédée en cours d’instance en laissant pour lui succéder sa fille qui a accepté la succession à concurrence de l’actif net. Pour déclarer irrecevables comme éteintes toutes les demandes formées par les locataires contre la succession de leur bailleur, la cour d’appel, après avoir constaté le défaut de déclaration de créances dans le délai imparti, retient que, les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière par le tribunal n’étant pas définitives, il importe peu que certaines aient été exécutées. Sa décision est censurée par la Cour de cassation.
Selon l’article 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci.
Il résulte de l’article 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1342, alinéa 3, du code civil que le paiement éteint la dette.
Ainsi, en statuant comme elle l’a fait, alors que les paiements effectués en vertu du jugement exécutoire par provision avaient éteint les créances correspondantes des locataires, de sorte que ceux-ci n’étaient pas soumis à l’obligation de les déclarer à la succession, la cour d’appel a violé les articles 792, 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1342, alinéa 3, du code civil.

Commentaires récents