Actualité jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale, divorce, enlèvement d’enfants, état civil/nationalité, majeurs protégés, mariage/DIP, régimes matrimoniaux, successions
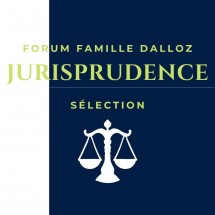 Une actualité très riche cette semaine :
Une actualité très riche cette semaine :
. autorité parentale,
. divorce
. enlèvement d’enfants
. état civil/nationalité
. majeurs protégés
. mariage/DIP
. régimes matrimoniaux
. successions
- AUTORITÉ PARENTALE
Résidence alternée : pas de partage de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de ses compléments entre les parents de l’enfant (Civ. 2e, 25 nov. 2021, n° 19-25.456) – Dès lors qu’en cas de résidence alternée l’un et l’autre des parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, l’attribution d’une prestation familiale ne peut être refusée à l’un des deux parents au seul motif que l’autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l’attribution de cette prestation à chacun d’entre eux implique la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.
La règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les allocations familiales et que si l’article L. 541-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-02 du 11 février 2005, prévoit que les dispositions de l’article L. 521-2 sont applicables à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ce renvoi n’inclut pas les dispositions du deuxième alinéa de ce texte (partage par moitié des allocations familiales en cas de résidence alternée), édictées postérieurement. En outre, les règles particulières à l’AEEH et ses compléments, qui font dépendre leur attribution non seulement de la gravité du handicap de l’enfant mais également des charges supplémentaires et sujétions professionnelles que le handicap a générées pour le parent, ne permettent pas leur attribution à chacun des parents de l’enfant en résidence alternée sans la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ou du règlement.
NB – Sur le refus de renvoyer au Conseil constitutionnelle la QPC relatve aux articles L. 513-1, L. 521-2 et L. 541-3 du code de la sécurité sociale, v. Civ. 2e, 8 oct. 2020, n° 19-25.456.
- DIVORCE
Compétence juridictionnelle pour connaître d’une demande en divorce un époux ne peut avoir qu’une seule résidence habituelle (CJUE, 25 nov. 2021, n° C-289/20) – La Cour de Justice de l’Union européenne précise le sens et la portée de la notion de « résidence habituelle » d’un époux. L’article 3, § 1, sous a), du Règlement (CE) n° 2201/2003, du 27 novembre 2003, dit “Bruxelles II bis”, doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’attribution de compétence, chaque conjoint ne peut se voir reconnaître qu’une résidence habituelle (la formule est au singulier et l’adjectif “habituelle” renvoie à un aspect de stabilité ou de régularité et s’entend comme le centre permanent ou habituel des intéressés).
Quand un conjoint partage sa vie entre deux ou plusieurs États membres de telle sorte qu’il n’est aucunement possible de considérer l’un de ces États comme étant celui de sa résidence habituelle au sens de cet article 3, § 1, sous a), la compétence judiciaire internationale doit être déterminée conformément à d’autres critères prévus par ce règlement et, le cas échéant, conformément aux critères résiduels en vigueur dans les États membres.
Dans ce même cas de figure, la compétence peut être exceptionnellement attribuée aux juridictions des États membres d’une résidence non habituelle d’un conjoint, lorsque l’application du Règlement n° 2201/2003 et des fors résiduels ne fait ressortir la compétence internationale d’aucun État membre.
NB – Cette décision sera prochainement commentée dans l’AJ famille par Delphine Eskenazi.
Le PV de difficultés interrompt le délai quinquennal de prescription quant à la demande d’indemnité d’occupation (Civ. 1re, 17 nov. 2021, n° 20-14.914) – Il résulte des articles 815-9, alinéa 2, 815-10, alinéa 3, du code civil que, lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir, au bénéfice de l’indivision, qu’une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d’interruption ou de suspension de la prescription.
Il résulte de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que le délai de cinq ans prévu par le l’article 815-10 est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés dès lors que celui-ci fait état d’une demande de fixation d’une indemnité pour l’occupation d’un bien indivis.
Pour dire que l’indemnité d’occupation due par l’ex-femme à l’indivision post-communautaire est de 10 883 €, l’arrêt retient que le divorce des époux est devenu définitif le 6 avril 2007, que le délai de prescription quinquennale quant à la demande d’indemnité d’occupation a couru à compter de cette date pour expirer le 6 avril 2012 et que le PVl de difficultés, établi le 19 avril 2012, soit postérieurement à l’expiration de ce délai, n’a pas pu interrompre la prescription. Il ajoute que, lorsque la demande d’indemnité d’occupation a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l’indemnité due ne peut porter que sur les cinq années qui précèdent la demande, qui a été formulée le 20 juillet 2012 par l’assignation délivrée par l’ex-mari. Il relève que celui-ci reconnaît que la remise des clés, le 2 mars 2008, a fait cesser la jouissance privative. Il en déduit que la demande d’indemnité d’occupation n’est recevable que pour la période s’étendant du 20 juillet 2007 au 2 mars 2008, celle portant sur la période antérieure étant prescrite.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que, le procès-verbal du 19 avril 2012 était de nature à interrompre la prescription de la demande formée par l’ex-mari, de sorte que celui-ci était en droit d’obtenir, au bénéfice de l’indivision, une indemnité d’occupation portant sur les cinq années qui précédaient sa demande, soit à compter du 19 avril 2007, la cour d’appel la violé les textes susvisés.
NB – V. déjà Civ. 1re, 7 févr. 2018, n° 16-28.686, AJ fam. 2018. 231, obs. J. Casey.
- ENLÈVEMENT D’ENFANTS
Le retour d’un enfant en Thaïlande, ordonné par les juridictions suisses dans une procédure d’enlèvement international, n’a pas violé la Convention (S.N. et M.B.N. c/ Suisse, n° 12937/20) – En l’occurrence, pour s’opposer au retour, la mère arguait d’attouchements sexuels que le père aurait commis en Thaïlande sur l’enfant.
Sur la question de la poursuite de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment exclusion de tout « risque grave », la Cour estime, entre autres, que les implications qu’un retour en Thaïlande aurait pour l’enfant ont fait l’objet d’un examen circonstancié par les tribunaux suisses, aussi bien s’agissant de la sécurité de l’enfant que la situation financière de sa mère. La Cour observe, en particulier, qu’à aucun moment de la procédure interne, un retour de l’enfant seule n’a été envisagé par les autorités compétentes et que la mère a toujours affirmé qu’elle accompagnerait sa fille en cas de retour. Le tribunal cantonal a estimé, dans son arrêt du 28 juin 2019, que la mère n’avait pas noué en Suisse des relations d’une solidité qu’on ne pouvait raisonnablement attendre de celle-ci qu’elle retourne en Thaïlande. Les tribunaux ont également constaté, sans tomber dans l’arbitraire, que la situation financière de la première requérante lui permettrait de s’occuper de son enfant et qu’elle n’aurait pas à craindre des poursuites pénales par les autorités thaïlandaises. La Cour conclut que le processus décisionnel a poursuivi l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il a permis d’exclure tout risque grave pour l’enfant au sens de l’article 13 de la Convention de La Haye.
Sur la question de la prise en compte de l’opinion de l’enfant, le Tribunal fédéral estima également que l’article 13, al. 2, de la Convention de La Haye n’avait pas été violé, car l’enfant, âgée de sept ans, n’apparaissait pas avoir atteint une maturité suffisante pour être capable de distinguer le fait d’habiter en Thaïlande de celui de loger chez ou à proximité de son père. Selon la haute Cour, l’enfant aurait en effet refusé catégoriquement toute forme de retour, sans nuance.
Sur la question de l’intégration de l’enfant en Suisse, le délai d’un an de l’article 12, alinéa 2, n’était pas acquis pour pouvoir s’opposer au retour : la mère a quitté le Thaïlande fin avril 2018 pour s’installer en Suisse avec son enfant. Le père de l’enfant a saisi le tribunal cantonal le 23 août 2018, à savoir quatre mois plus tard.
Conclusions générales : on ne saurait prétendre que les tribunaux internes aient ordonné le retour de l’enfant de façon automatique ou mécanique. Bien au contraire, dans une procédure contradictoire, équitable et orale, ceux-ci se sont basés sur les faits pertinents de l’affaire et ont dûment pris en compte tous les arguments des parties et ont rendu des décisions détaillées qui, selon eux, poursuivaient l’intérêt supérieur de l’enfant et ont permis d’exclure tout risque grave pour l’enfant. Par ailleurs, les autorités compétentes ont entrepris des démarches appropriées en vue de garantir la sécurité de l’enfant dans l’éventualité de son retour en Thaïlande. La Cour conclut que le processus décisionnel a satisfait aux exigences de l’article 8 de la Convention et que, partant, l’ingérence dans le droit des requérantes au respect de leur vie familiale était nécessaire dans une société démocratique. Dès lors, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
- ÉTAT CIVIL/NATIONALITÉ
La contradiction retire toute valeur probante à l’acte de naissance établi sur déclaration du père prétendument analphabète qui ne l’a pas signé alors qu’il avait signé son acte de mariage (Civ. 1re, 17 nov. 2021, n° 20-22.244) – Ayant constaté que l’acte de naissance, au vu duquel un certificat de nationalité avait été délivré à l’intéressé, avait été dressé par l’officier de l’état civil sur la déclaration de son père prétendu, mais sans la signature de celui-ci, avec la mention « nous avons signé seul, le déclarant ne le sachant », alors qu’il résultait de l’acte de mariage de ce dernier, dressé quatre ans auparavant par un officier français de l’état civil, qu’il savait signer, la cour d’appel, devant qui l’article 8 de la Conv. EDH n’était pas invoqué, a souverainement estimé que cette contradiction ne permettait pas de reconnaître à cet acte la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil aux actes de l’état civil étranger.
- MAJEURS PROTÉGÉS
Du renouvellement de la tutelle (Civ. 1re, 17 nov. 2021, n° 19-14.872) – Pour renouveler la mesure de tutelle, une cour d’appel retient que, si les constatations du certificat médical établi en vue de la révision de la mesure de protection ne valent que pour l’état de santé de la majeure à la date de son établissement, soit le 2 décembre 2016, celle-ci n’apporte aucun élément récent venant les contredire, ce certificat faisant état de la persistance de sa pathologie psychiatrique, de sorte qu’est suffisamment caractérisé un état d’altération mentale nécessitant que l’intéressée soit représentée dans toutes les actes de la vie civile. En se déterminant ainsi, sans constater la persistance d’une altération des facultés mentales de l’intéressée, et, partant, la nécessité pour celle-ci d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
NB – Sur la mesure de tutelle et son renouvellement, v. notre fiche “Tutelle” en accès libre.
Le bénéficiaire de contrats d’assurance vie, qui ne les a pas acceptés avant leur modification, dispose de 15 jours à compter de l’ordonnance modificative de ses droits par le juge des tutelles pour faire appel (Civ. 1re, 17 nov. 2021, n° 20-12.711) – Aux termes de l’article 1230 du code de procédure civile, toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l’administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
Selon l’article 1239 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, les personnes énumérées à l’article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance, peuvent former appel des décisions du juge dans un délai de quinze jours.
Selon l’article 1241-1 du code de procédure civile, le délai d’appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court, à l’égard des personnes à qui l’ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification et, à l’égard des autres personnes, à compter de l’ordonnance.
Il résulte de l’article L. 132-9 du code des assurances que seule l’acceptation du bénéfice du contrat d’assurance sur la vie par le bénéficiaire, avant son dénouement, a pour effet de rendre irrévocable la désignation et que, en l’absence d’une telle acceptation, le souscripteur reste libre de la modifier.
Pour déclarer recevable l’appel formé par l’un des bénéficiaires des contrats d’assurance vie – fils de la défunte souscripteur finalement placée sous tutelle -, l’arrêt retient que l’ordonnance du juge des tutelles du 11 février 2013 aurait dû lui être notifiée, dès lors qu’elle a modifié le quantum des droits de celui-ci dans les contrats d’assurances sur la vie souscrits par sa mère et qu’en l’absence d’une telle notification le délai d’appel n’a pas commencé à courir. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’acceptation du bénéfice de ces contrats, il n’avait aucun droit acquis à leur capital, de sorte que l’ordonnance litigieuse n’avait pas à lui être notifiée, la cour d’appel a violé les articles 1230, 1239, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, et 1241-1 du code de procédure civile, et l’article L. 132-9 du code des assurances.
Faisant application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation statue au fond. Le fils n’ayant pas accepté le bénéfice des contrats d’assurance sur la vie avant leur modification, il ne pouvait se prévaloir d’aucun droit acquis à leur capital, de sorte que l’ordonnance précitée n’avait pas à lui être notifiée. Il s’en déduit que, le délai d’appel de quinze jours ayant commencé à courir à compter du 11 février 2013, l’appel formé le 15 janvier 2018 est irrecevable.
- MARIAGE/DIP
Un mariage bigame n’est pas nécessairement dénué d’effet (Civ. 1re, 17 nov. 2021, n° 20-19.420) – En matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle, d’autre part, que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux (C. civ., art. 3).
Pour déclarer irrecevable la requête en divorce de l’épouse, une cour d’appel retient que, avant son mariage avec celle-ci, l’époux avait contracté une précédente union en Libye et que, la loi française ne reconnaissant pas la bigamie, ce second mariage n’a pas d’existence légale et ne peut donc être dissous par une juridiction française. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la loi personnelle des époux, dont elle avait constaté qu’ils étaient tous deux libyens, n’autorisait pas la bigamie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
NB – La cassation était inévitable. La cour d’appel aurait dû rechercher si la loi libyenne, loi personnelle des époux, autorisait la bigamie. Elle ne pouvait d’emblée déclarer irrecevable la requête sans procéder à cette recherche préalable. Et ce n’est que dans un second temps, si la réponse devait être négative, qu’elle pouvait ainsi trancher. C’est Alexandre Boiché qui commentera prochainement cette décision dans l’AJ famille.
- RÉGIMES MATRIMONIAUX
La cessation de l’activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale (Com., 17 nov. 2021, n° 20-20.821) – Selon l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015, applicable en la cause, la déclaration notariée d’insaisissabilité de la résidence principale que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Il en résulte que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.
NB – On rappellera que l’insaisissabilité de la résidence principale est de droit depuis le 8 août 2015.
- SUCCESSIONS
Liquidation et partage de successions : valeur du rapport (Civ. 1re, 17 nov. 2021, n° 19-23.218) – Aux termes de l’article 860, alinéas 1 et 2, du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Pour fixer le montant de l’indemnité de rapport dû par l’un des enfants au titre d’un immeuble reçu de sa mère en donation en 1966, une cour d’appel déduit du prix de l’aliénation du bien réalisée en 2007 le montant des travaux et dépenses justifiés par elle. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l’époque du partage dans l’état où il se trouvait, au moment de la donation, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux travaux réalisés par la donataire, la cour d’appel a violé l’article 860, alinéas 1 et 2, du code civil.

Commentaires récents