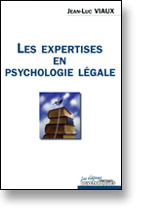 Très peu d’ouvrages sont consacrés à l’expertise psychologique. Ce qui rend l’ouvrage de Jean-Luc Viaux « Les expertises en psychologie légale » d’autant plus précieux. Ce livre est destiné tant aux psychologues qu’à ceux qui les sollicitent ou encore à ceux à qui le justice ordonne de se rendre dans un cabinet d’expert. Il traite naturellement de l’expertise tant dans le cadre pénal (1re partie) que dans le cadre du contentieux familial (2e partie).
Très peu d’ouvrages sont consacrés à l’expertise psychologique. Ce qui rend l’ouvrage de Jean-Luc Viaux « Les expertises en psychologie légale » d’autant plus précieux. Ce livre est destiné tant aux psychologues qu’à ceux qui les sollicitent ou encore à ceux à qui le justice ordonne de se rendre dans un cabinet d’expert. Il traite naturellement de l’expertise tant dans le cadre pénal (1re partie) que dans le cadre du contentieux familial (2e partie).
Voir un extrait de l’ouvrage « Les expertises en psychologie légale », Les Éditions du journal des psychologues, mars 2011
Les envois, remises et notifications des actes de procédures, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles doivent répondre aux garanties fixées par l’arrêté du 10 avril 2011 lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou une personne désignée en application de l’article 449 du code civil et un tribunal d’instance, dans le cadre d’une mesure de protection judiciaire des majeurs.
Danièle Ganancia, vice-président au TGI du Paris et référent pour la médiation, a organisé le 11 mars 2011, en partenariat avec l’ ENM, une matinée découverte des techniques de la médiation. Elle y a notamment présenté l’organisation mise en place à Paris pour impulser et développer la médiation dans les chambres civiles.
À la suite des réflexions de la commission MAGENDIE et du rapport déposé en 2008 sur « Célérité et qualité de la justice, la médiation une autre voie », auquel j’ai coopéré en tant que membre de la commission Magendie, nous avons mis en place en 2009 une réflexion et une action au tribunal, en concertation entre le Président et les magistrats, pour implanter et développer la médiation dans les chambres civiles (la médiation familiale étant déjà institutionnalisée depuis 2007). Lire la suite…
À la manière d’un troc, les avocats obtiennent « l’acte d’avocat » et les notaires l’acte de notoriété et l’enregistrement du pacs. La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, publiée au Journal officiel du 29, offre à chacun des acteurs des deux professions de nouvelles opportunités. Sauf que les premiers ont le sentiment d’être lésés, ne voyant pas bien ce que l’acte d’avocat leur apportera en droit de la famille (V. notre billet du 14 oct. 2010)… Lire la suite…
La lutte contre les violences familiales, longtemps taboues, est désormais au cœur des préoccupations du législateur français. En témoigne la récente adoption de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 (relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants), complétée par le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 (relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples). Ces textes démontrent que le traitement juridique des violences conjugales impose de combiner droit de la famille et droit pénal. Mais l’efficacité de la lutte contre les violences familiales passe également par des rencontres et des échanges entre les professionnels du monde judiciaire et du monde social. C’est pourquoi l’IEJ de Lyon et le Centre de droit de la famille se proposent de réunir les praticiens du droit (avocats, magistrats…) et les acteurs sociaux (associations, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés…) de la région Rhône-Alpes.
L’AJ famille s’associe à l’événement qui aura lieu le 12 avril 2011, du 14 heures à 19 heures :’Université Lyon 3, Amphi Roubier.
Responsables scientifiques : Anne-Sophie Chavent-Leclère et Alain Devers Maîtres de conférences à l’Université Lyon 3
Contacts : iej@univ-lyon3.fr ou julien.couard@univ-lyon3.fr
Voir le programme
S’inscrire
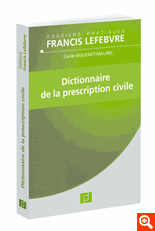 Je vous signale la parution d’un ouvrage qui n’est pas spécifiquement propre au droit de la famille, mais qui peut toutefois s’avérer bien utile lorsqu’il s’agit d’agir dans les délais : Le « Dictionnaire de la prescription civile »‘.
Je vous signale la parution d’un ouvrage qui n’est pas spécifiquement propre au droit de la famille, mais qui peut toutefois s’avérer bien utile lorsqu’il s’agit d’agir dans les délais : Le « Dictionnaire de la prescription civile »‘.
Acheter cet ouvrage
C. Biguenet-Maurel, Dictionnaire de la prescription civile, Francis Lefèbvre « Dossiers pratiques », févr. 2011 : 64,60 euros (au lieu de 68 euros)
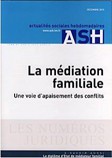 À l’heure où l’on parle de plus en plus de modes alternatifs de règlement des litiges, je vous signale la parution du numéro spécial ASH (Actualités sociales hebdomadaires) : « La médiation familiale. Une voie d’apaisement des conflits ».
À l’heure où l’on parle de plus en plus de modes alternatifs de règlement des litiges, je vous signale la parution du numéro spécial ASH (Actualités sociales hebdomadaires) : « La médiation familiale. Une voie d’apaisement des conflits ».
Ce dossier, réalisé par Sophie André, juriste en droit de l’aide et de l’action sociale, aborde successivement les principes généraux de la médiation, ses conditions d’exercice, son cadre juridique, le financement des services et les conditions requises pour être médiateur (diplôme d’État de médiateur familial).
La médiation familiale. Une voie d’apaisement des conflits, ASH, déc. 2010
Au plus tard le 1er septembre 2011, le juge du tribunal d’instance connaîtra des procédures de surendettement au lieu et place du juge de l’exécution. A Dijon, sans même attendre la publication de la loi n° 2010-1009 du 22 décembre 2010 qui impose ce transfert, le président du Tribunal de grande instance de Dijon, Gilles Rolland, annonçait au début du mois de décembre que ce transfert aurait lieu au 1er janvier 2011 dans les tribunaux d’instance de Dijon, Beaune et Monbard. Les dossiers de la Banque de France leur seront transférés. S’il continuera à gérer le stock des affaires en cours, le tribunal de grande instance ne traitera plus aucun nouveau dossier. « Ce moyen d’anticipation devrait permettre d’arriver à un rythme normal de suivi. Sur un an, le retard devrait être rattrapé », a commenté le président.
Les plafonds de l’aide juriditionnelle pour 2011 ont été modifiés par la loi de Finances. La moyenne mensuelle des revenus perçus en 2010 doit être inférieure ou égale à 929 euros pour l’aide juridictionnelle totale et comprise entre 930 et 1 393 euros pour l’aide juridictionnelle partielle. Il convient d’ajouter à ces montants 167 euros pour chacune des deux premières personnes vivant au domicile du demandeur (ex : enfants, conjoint, concubin ou partenaire d’un pacs) et 106 euros à partir de la troisième.
Pour régler les conflits d’autorité parentale, l’article 373-2-10 du code civil autorise le juge aux affaires familiales à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur familial. Le décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 entend expérimenter, jusqu’au 31 décembre 2013, les modalités d’application qu’il détermine dans les tribunaux de grande instance ultérieurement désignés par arrêté. Dans ces tribunaux, les parties seront informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l’audience. Il sera indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l’association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision sera adressée par courrier, il leur sera en outre rappelé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologuera, le cas échéant, l’accord intervenu ; en l’absence d’accord ou d’homologation, il tranchera le litige.
Et pour développer davantage les échanges entre les différents acteurs judiciaires en matière familiale, ce même texte prévoit les modalités de désignation d’un magistrat coordonnateur de l’activité en matière de droit de la famille et des personnes au sein de chaque tribunal de grande instance et cour d’appel.
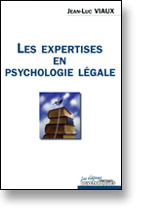 Très peu d’ouvrages sont consacrés à l’expertise psychologique. Ce qui rend l’ouvrage de Jean-Luc Viaux « Les expertises en psychologie légale » d’autant plus précieux. Ce livre est destiné tant aux psychologues qu’à ceux qui les sollicitent ou encore à ceux à qui le justice ordonne de se rendre dans un cabinet d’expert. Il traite naturellement de l’expertise tant dans le cadre pénal (1re partie) que dans le cadre du contentieux familial (2e partie).
Très peu d’ouvrages sont consacrés à l’expertise psychologique. Ce qui rend l’ouvrage de Jean-Luc Viaux « Les expertises en psychologie légale » d’autant plus précieux. Ce livre est destiné tant aux psychologues qu’à ceux qui les sollicitent ou encore à ceux à qui le justice ordonne de se rendre dans un cabinet d’expert. Il traite naturellement de l’expertise tant dans le cadre pénal (1re partie) que dans le cadre du contentieux familial (2e partie).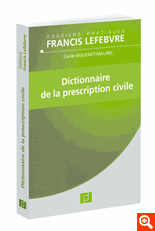
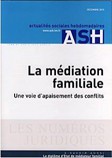

Commentaires récents