Le décret n° 2010-1520 du 9 décembre 2010 porte publication de la convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, signée à New York le 10 décembre 1962. La loi n° 2007-1163 du 1er août 2007 avait autorisé la France à y adhérer. Cette convention impose aux États signataires de fixer un âge minimum pour le mariage et exige que l’autorité compétente pour le célébrer s’assure du libre consentement des parties, exprimé personnellement, en présence de témoins et après une publicité suffisante (sauf circonstances exceptionnelles) et que le consentement a bien été reçu dans les formes légales par une autorité habilitée. Tous les mariages doivent être inscrits sur un registre officiel.
La baisse du nombre de mariages s’est encore accélérée en 2009. Ce sont 251 478 mariages qui ont été enregistrés en France, soit 14 000 mariages de moins qu’en 2008 (- 5,2 %). A l’inverse, en France métropolitaine, la proportion de remariages est passée, en trente ans, de 12 % à 21 % pour les hommes et de 11 % à 19 % pour les femmes. Quant à la part des mariages mixtes, elle est en légère augmentation par rapport à 2008, passant de 15,6 % à 16,1 %.
En moyenne, les femmes se marient pour la première fois à 30,7 ans et les hommes à 32,8 ans. En huit ans, l’âge moyen au premier mariage a augmenté de deux années pour les deux conjoints.
Les divorcés se consolent vite. C’est après un an de divorce que les remariages sont les plus nombreux. Pour les veufs c’est après trois ans de veuvage, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Statistiques d’état civil sur les mariages en 2009, Insee résultats, n° 115 société, nov. 2010
Le 6 octobre dernier le Conseil constitutionnel décidait que le refus de l’adoption au sein d’un couple homosexuel n’était pas contraire à la Constitution. Une déception pour tous ceux qui militent ardemment en faveur des droits des homosexuels, mais en aucun cas une capitulation.
Déjà, il demeure toujours une lueur d’espoir du côté de l’Europe avec l’affaire Gas et Dubois c/ France qui sera prochainement tranchée par la Cour européenne des droits de l’homme. Ensuite, la Cour de cassation vient de transmettre une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité : celle de la conformité à la Constitution des articles 144 et 75, dernier alinéa, du code civil en ce qu’ils limitent la liberté individuelle d’un citoyen français de contracter mariage avec une personne du même sexe et interdisent au juge judiciaire d’autoriser de contracter mariage entre personnes du même sexe. Lire la suite…
Dans son arrêt, définitif, rendu le 2 novembre 2010 dans l’affaire Serife Yigit c/ Turquie (requête n° 3976/05), la grande Chambre de la CEDH confirme la décision de chambre du 20 janvier 2009. La législation turque, qui refuse aux personnes mariées religieusement le bénéfice des droits de santé et de pension retraite de leur défunt compagnon au motif que la législation de cet État ne reconnaît que le mariage civil, n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale). Lire la suite…
Le mariage est juridiquement valable dès l’échange des consentements des époux devant l’officier de l’état civil lors de la célébration. L’article 75 du code civil prévoit que le maire ou son adjoint déclare alors, au nom de la loi, que les parties sont unies par le mariage. L’acte de l’état civil est dressé sur le champ afin de rapporter la preuve du mariage par un acte authentique. Ainsi, aucun principe de droit ne s’oppose à ce que l’un des époux voire les deux signent l’acte de mariage de leur nom d’usage conféré par cette union. En outre, l’article 1316-4 du code civil précise que la signature nécessaire à la perfection de l’acte identifie celui qui l’appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Celle-ci doit simplement permettre de vérifier que les personnes signataires de l’acte sont bien celles désignées dans celui-ci. La personne est donc libre de signer comme elle le souhaite, sous son nom de famille ou son nom d’usage, dès lors que cette signature permet de l’identifier.
Rép. min. n° 78794, JOAN Q 19 oct. 2010, p. 11443
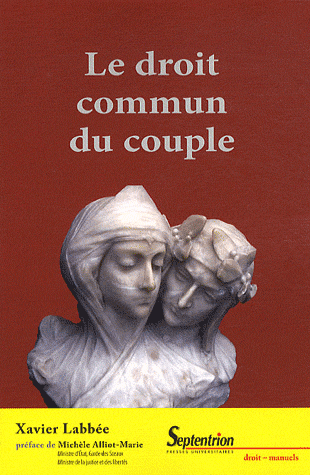 La diversité des modes de conjugalité ne fait pas pour autant disparaître la famille. Bien au contraire, c’est le couple qui fait la famille. Le mariage, le pacs et le concubinage ne sont finalement pas si différents. Ne serait-il pas temps de penser à un droit conjugal uniformisé, à un droit commun du couple ? Et si cet autre système n’était autre que le droit commun des obligations ? Comme le relève Jean-Jacques Taisne, « la morale contractuelle faite de loyauté, de fidélité et de respect de la parole donnée peut constituer l’esquisse d’un nouvel ordre public matrimonial, et favoriser la reconstruction d’un droit de la famille à ce jour trop éclaté ».
La diversité des modes de conjugalité ne fait pas pour autant disparaître la famille. Bien au contraire, c’est le couple qui fait la famille. Le mariage, le pacs et le concubinage ne sont finalement pas si différents. Ne serait-il pas temps de penser à un droit conjugal uniformisé, à un droit commun du couple ? Et si cet autre système n’était autre que le droit commun des obligations ? Comme le relève Jean-Jacques Taisne, « la morale contractuelle faite de loyauté, de fidélité et de respect de la parole donnée peut constituer l’esquisse d’un nouvel ordre public matrimonial, et favoriser la reconstruction d’un droit de la famille à ce jour trop éclaté ».
Préfacé par Michèle Alliot-Marie, l’ouvrage de Xavier Labbée, qui envisage le couple dans sa formation, ses devoirs, mais aussi ses crises et sa rupture, intéressera tous ceux qui sont confrontés au contentieux du couple et tous ceux qui réfléchissent à la place de la famille dans l’organisation sociale.
Xavier Labbée, Le droit commun du couple, PU Septentrion, coll. « droit-manuels », 15,2 €
La Commission internationale de l’état civil (CIEC) vient de publier sur son site une étude sur les mariages de complaisance dans les États membres de la CIEC. Les avantages liés au mariage pouvant être vecteurs de fraude, les États ont mis en place des mesures tantôt préventives, tantôt a posteriori, l’une des difficultés majeures étant de ne pas méconnaître la liberté du mariage telle qu’elle est garantie par l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Lire l’étude
À compter du 1er mai 2011, les officiers d’état civil seront tenus de lire aux futurs époux l’article 220 du code civil relatif à leurs engagements contractuels en matière de dépenses du ménage.
Publiée chaque année depuis la fin des années 1970, l’enquête « conditions de vie et aspirations » du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) révèle qu’en France l’opinion est en train de basculer en faveur de l’homoparenté. En 2010, près d’un Français sur deux (48 %) estime qu’un couple homosexuel devrait pouvoir adopter un enfant alors qu’il y a quatre ans 40 % seulement de la population y étaient favorables. Et 61 % considèrent que deux personnes de même sexe devraient pouvoir s’unir civilement à la mairie, contre 55 % en 2007.
R. Bigot, L’opinion défend à la fois la liberté individuelle et la cohésion sociale, Consommation et modes de vie, juill. 2010
Eric Besson s’est opposé à l’acquisition de la nationalité par mariage d’un ressortissant marocain qui ne pouvait être considérée comme assimilé aux us et coutumes de la société française. Lors de l’enquête administrative, il avait « refusé de serrer la main de l’agent féminin qui l’a reçu au motif que « c’était contraire à sa religion ». Son épouse, vêtue d’un voile intégral, n’a accepté de se dévoiler qu’à condition qu’aucun homme ne soit présent. S’agissant de l’interdiction du port du voile à l’école, l’intéressé a déclaré ne pas en être informé. S’agissant de la laïcité, l’intéressé a déclaré : « chacun fait ce qu’il veut ». La seule motivation déclarée par l’intéressé pour acquérir la nationalité française est d’« être tranquille pour les papiers » ».
Pour Eric Besson, la condition d’assimilation prévue par l’article 21-4 du code civil n’était pas remplie. Par suite, il lui a fait notifier le 8 juillet 2010 un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité française.
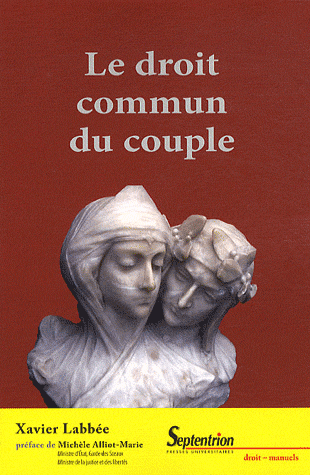

Commentaires récents