Sélection jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale, divorce, droit international privé, filiation, libéralités, mariage, procédure familiale, successions
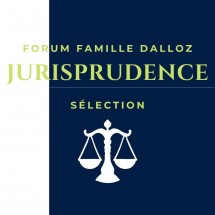 De beaux arrêts à vous livrer cette semaine dans les matières suivantes :
De beaux arrêts à vous livrer cette semaine dans les matières suivantes :
- autorité parentale
- divorce
- droit international privé
- filiation
- libéralités
- mariage
- procédure familiale
- successions
- AUTORITÉ PARENTALE / FILIATION
GPA : impossibilité d’obtenir le retrait de l’autorité parentale à l’encontre de la mère porteuse (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 20-18.687, 664 F-B) – Il résulte de l’article 378-1, alinéa 1er, du code civil qu’un défaut de soins ou un manque de direction ne peut justifier le retrait de l’autorité parentale que s’il met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.
En l’occurrence, le père alléguant avoir eu recours à une gestation pour autrui a assigné la mère de nationalité indienne – qui avait renoncé à tous ses droits parentaux par déclaration du 30 juillet 2010 – en retrait de l’autorité parentale sur ses deux enfants.
Or, la cour d’appel a rappelé que le retrait de l’autorité parentale, qui est une mesure de protection de l’enfant, suppose la démonstration par le requérant d’un danger manifeste pour la santé, la sécurité ou la moralité de ce dernier. Elle a relevé que l’ensemble des pièces communiquées démontrait que les deux enfants étaient équilibrés, heureux et parfaitement pris en charge. Procédant aux recherches prétendument omises, elle a souverainement retenu qu’il n’était produit aucune pièce propre à démontrer que l’absence de leur mère soit source de danger pour eux et que le père n’établissait pas en quoi la protection de l’ intérêt supérieur des ces deux enfants commandait le retrait d’autorité parentale de la mère, le dispositif conventionnel et législatif n’ayant pas vocation à faciliter ses démarches administratives.
La cour d’appel n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, prévu par l’article 8 de la Conv. EDH dès lors, d’une part, que ce droit n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis, d’autre part, que la voie de l’adoption des enfants par le conjoint du père demeure ouverte, si les conditions en sont remplies, ce qui suppose en particulier que le juge vérifie la validité et la portée de déclaration du 30 juillet 2010 par laquelle la mère a renoncé à ses droits parentaux et qu’il s’assure de sa conformité avec l’intérêt de l’enfant.
Elle n’a pas davantage violé l’interdiction de toute discrimination posée par l’article 14 de la Convention, les dispositions de l’article 378 du code civil s’appliquant indifféremment à tous les enfants, sans distinction aucune fondée sur la naissance.
Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
NB – Cette décision sera prochainement commentée par Florent Berdeaux dans les colonnes de l’AJ famille.
La délégation d’autorité parentale aux fins d’adoption d’un enfant à Papeete ne consacre pas une relation fondée sur une convention de GPA (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.042, 660 FS-B+R) – Un couple hétérosexuel a obtenu d’un juge aux affaires familiales polynésien la délégation de l’exercice de l’autorité parentale sur leur enfant au profit d’un autre couple hétérosexuel. Décision confirmée en appel par la cour d’appel de Papeete. Or, le procureur général près la cour d’appel fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de délégation d’autorité parentale, alors « qu’en statuant ainsi la cour d’appel a enfreint la prohibition d’ordre public de la gestation pour autrui spécifiée aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. » Tous ses arguments sont rejetés par la Cour de cassation :
- le projet d’une mesure de délégation d’autorité parentale, par les parents d’un enfant à naître, au bénéfice de tiers souhaitant le prendre en charge à sa naissance, n’entre pas dans le champ des conventions prohibées par l’article 16-7 du code civil (aucune atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, dès lors que l’enfant n’a pas été conçu en vue de satisfaire la demande des candidats à la délégation et que la mesure de délégation, qui n’est qu’un mode d’organisation de l’exercice de l’autorité parentale, ordonnée sous le contrôle du juge, est révocable et est, en elle-même, sans incidence sur la filiation de l’enfant). En l’occurrence, la cour d’appel a constaté que la mesure de délégation d’autorité parentale avec prise de contact d’une famille en métropole n’avait été envisagée par les parents de l’enfant qu’au cours de la grossesse. Elle en a exactement déduit que la mesure sollicitée ne consacrait pas, entre les délégants et les délégataires, une relation fondée sur une convention de gestation pour autrui ;
- les dispositions de l’article 377, alinéa 1er, du code civil n’interdisent pas la désignation de plusieurs délégataires lorsque, en conformité avec l’intérêt de l’enfant, les circonstances l’exigent ;
- si la cour d’appel a bien méconnu l’article 377, alinéa 1er, du code civil en accueillant la demande en délégation de l’exercice de l’autorité parentale au profit d’un couple dépourvu de lien avec les délégants et rencontré dans le seul objectif de prendre en charge l’enfant en vue de son adoption ultérieure, la mise en oeuvre de la jurisprudence nouvelle peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que, en ces circonstances, le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu’il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s’il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste. En l’occurrence, il résulte tout à la fois de la carence des dispositions réglementaires en Polynésie française, de l’aménagement en conséquence d’une mesure préalable de délégation d’autorité parentale aux fins d’adoption et de son admission sur ce territoire par une jurisprudence trentenaire de la cour d’appel de Papeete qu’à la date de la naissance de l’enfant les parents légaux, comme le couple candidat à la délégation, se sont engagés dans un processus de délégation d’autorité parentale en vue d’une adoption qu’ils pouvaient, de bonne foi, considérer comme étant conforme au droit positif. Qui plus est, l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle porterait également une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces circonstances exceptionnelles justifient par conséquent de déroger à l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle aux situations des enfants pour lesquels une instance est en cours.
NB – Les particularités de l’adoption en Polynésie française, souvent critiquées, doivent cesser. Cette décision sera prochainement commentée par Florent Berdeaux dans les colonnes de l’AJ famille (v. égal. les autres arrêts du même jour, n° 21-50.048, 21-50.049, 21-50.050 et 21-50.051 et 21-50.052. – v. égal. 21-50.040).
Le rapport de la conseillère, Caroline Azar, et l’avis de l’avocate générale, Anne Caron-Déglise, sont disponibles sur le site de la Cour de cassation.
Le légataire universel ne peut poursuivre l’action en contestation de paternité engagée par le défunt (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 20-21.035, 657 F-B) – Après avoir énoncé à bon droit que le légataire universel du titulaire de l’action prévue par l’article 333 du code civil, n’étant pas un héritier de celui-ci au sens de l’article 322 du même code, n’a pas qualité pour exercer cette action ni pour la poursuivre, la cour d’appel en a exactement déduit que les nièces du défunt étaient irrecevables à poursuivre, en leur qualité de légataires universelles, l’action en contestation de paternité qu’il avait engagée.
NB – V. déjà Civ. 1re, 2 avr. 2014, n° 13-12.480, AJ fam. 2014. 309, obs. Valérie George.
- DIVORCE
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l’un des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-12.344, 658 F-B) – Ici, l’époux faisait grief à une cour d’appel de le condamner à payer à son épouse une prestation compensatoire de 200 000 € sans rechercher comme elle y était invitée, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, si la liquidation de l’important patrimoine commun (montant global compris entre 850 000 € et 4 214 160 €) n’était pas de nature à réduire sensiblement les besoins de son épouse. En vain. “Sous le couvert d’un grief non fondé de manque de base légale au regard de l’article 271 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel qui, après avoir retenu à bon droit que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l’épouse pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux, a pris en considération l’ensemble des éléments qui lui était soumis pour fixer le montant de la prestation compensatoire.”
NB – Cette jurisprudence est constante (v. not. Civ. 1re, 21 sept. 2016, n° 15-14.986). On notera par ailleurs le rappel fait par la Cour de cassation aux juges du second degré quant aux demandes de dépens : la juridiction de renvoi doit impérativement statuer sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement (C. pr. civ., art. 639).
- LIBÉRALITÉS
Une décision accueillant une demande de délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d’exécution forcée (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 19-22.693, 670 FS-B) – Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. En application de l’article 1014 du code civil, la délivrance d’un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l’entrée en possession de l’objet du legs et l’acquisition des fruits, et se distingue du paiement du legs. Ce que la cour d’appel avait manifestement oublié dans cette affaire.
Pour rejeter la contestation de la fille du défunt qui s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, elle retient que ledit commandement de payer qui lui a été signifié en 2016 est fondé sur un titre exécutoire régulier et valable résultant de deux arrêts ayant définitivement jugé que le légataire à titre particulier d’une somme d’argent était fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible, ce qui s’interprète comme une décision ordonnant la délivrance qui est la reconnaissance par le juge de la régularité du titre du légataire.
En statuant ainsi, alors qu’une décision accueillant une demande de délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d’exécution forcée, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1014 du code civil.
- MARIAGE / DROIT DES SOCIÉTÉS
Revendication de la qualité d’associé dans la société de l’autre époux : encore faut-il ne pas y avoir renoncé (Com, 21 sept. 2022, n° 19-26.203, 534 FS-B) – En l’occurrence, deux époux ont contracté mariage le 17 juillet 1970, sans contrat préalable. 37 ans plus tard, l’époux, revendiquant le bénéfice des dispositions de l’article 1832-2 du code civil, a notifié à la société, dont son épouse était la gérante, son intention d’être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait effectué. Invoquant le refus de son épouse de lui communiquer les comptes de la société, il l’a assignée, ainsi que la société, aux fins de voir constater qu’il avait la qualité d’associé depuis le mois de juin 2007 et d’obtenir la communication de certains documents sociaux. Satisfaction lui a été donnée par la cour d’appel. Si bien que la société se pourvoit en cassation. Les deux premiers arguments sont rejetés :
- les articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l’époux exerçant une profession séparée, la société n’est pas recevable à se prévaloir de l’atteinte que la revendication, par l’époux, de la qualité d’associé, serait susceptible de porter au droit de son épouse d’exercer une telle profession ;
- l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil.
Mais le dernier prospère : l’époux n’avait-il pas renoncé à son droit ?
La Cour de cassation commence par relever qu’aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Or, la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.
Viole l’article 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure, la cour d’appel qui, pour dire que l’époux avait la qualité d’associé depuis le mois de juin 2007 et ordonner à la société de lui communiquer certains documents sociaux, retient que, si l’époux peut renoncer, lors de l’apport ou de l’acquisition des parts par son conjoint, ou ultérieurement, à exercer la faculté qu’il tient de l’article 1832-2, alinéa 3, du code civil, c’est à la condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque et que la renonciation tacite dont se prévalent l’épouse et la société ne suffit pas à faire obstacle à son droit d’exercer cette revendication.
NB – Plus largement, sur le divorce de l’entrepreneur, je vous invite à consulter le dossier AJ famille d’avril 2020, p. 205 s.
- SUCCESSIONS
Non-responsabilité de l’État pour durée excessive affectant les instances en liquidation et partage de la succession complexes (Civ. 1re, 14 sept. 2022, n° 20-20.286, 653 F-D) – Ayant pris en considération l’ensemble des éléments du litige, son degré de complexité, le comportement des parties et les décisions rendues, une cour d’appel a pu en déduire, selon la Cour de cassation, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la responsabilité de l’État n’était pas engagée.
En l’occurrence, après avoir relevé qu’entre le 12 mai 1984, date de la saisine initiale de la juridiction, et le 26 janvier 2015, date de la conclusion d’un accord entre les héritiers, de nombreuses procédures s’étaient succédé en apposition de scellés, en désignation d’un expert en référé, puis d’administrateur provisoire, en liquidation et partage, en évaluation de la créance de la mère du requérant envers la succession de l’époux de celle-ci, ainsi qu’en désignation d’administrateurs des biens successoraux, la cour d’appel a retenu que, de 1984 à 1993, trois décisions de justice avaient été rendues et que la première procédure s’était terminée par le rejet d’un pourvoi en cassation le 13 octobre 1993, sans que la mère de l’un des héritiers n’ait fixé sa créance, et que ceux ci n’avaient introduit l’instance en fixation de cette créance que trois ans plus tard.
Elle a encore retenu que le litige présentait un degré élevé de complexité, la succession étant échue à deux branches différentes, avec un patrimoine conséquent comprenant des biens immobiliers avec démembrement de propriété, et une partie de biens mobiliers revendiquée par l’héritier et sa mère, que les relations entre les parties étaient très conflictuelles avec la multiplication de procédures engagées, y compris de façon concomitante, qu’entre 1996 et 2015 cinq décisions de justice étaient intervenues dont deux arrêts de cassation, qu’au cours de la procédure plusieurs décès et placement sous tutelle étaient intervenus, que les parties avaient attendu de longs mois pour exercer les voies de recours et qu’elles avaient systématiquement échangé de longues écritures, parfois la veille de l’ordonnance de clôture, retardant ainsi l’issue du litige.
NB – Les hostilités autour de la succession ont tout de même débuté en 1983. Il y a de quoi s’interroger. Cela fait près de 40 ans que les héritiers s’étripent. Au moins trois autres décisions de la Cour de cassation ont été rendues dans cette affaire (Civ. 1re, 13 oct. 1993, n° 91-18.848, 12 déc. 2007, n° 06-15.547 et 23 févr. 2011, n° 09-70.745).
Cette décision du 14 septembre 2022 qui rejette la responsabilité de l’État doit être rapprochée d’une autre du même jour (Civ. 1re, 14 sept. 2022, n° 21-15.504, 654 F-D).
Le rapport des libéralités n’est pas le rapport des dettes (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 20-22.139, 669 FS-B) – En l’occurrence, l’une des deux filles des défunts fait grief à une cour d’appel de dire que le montant des fermages dus par elle à sa mère entre le 1er janvier 1994 et son décès le 9 mai 2011 devra être réintégré dans l’actif de la succession, alors « que seule une dette existante peut faire l’objet d’une libéralité. En conséquence, en décidant que le montant des fermages dus à sa mère entre le 1er janvier 1994 et son décès le 9 mai 2011 devra être réintégré dans l’actif de la succession cependant qu’elle constatait que les fermages échus entre 1994 et 2005 étaient prescrits, la cour d’appel aurait violé les articles 843 et 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause.
Cette argumentation est rejetée : ayant retenu souverainement que la renonciation de la mère à recouvrer les fermages échus entre 1994 et 2005 l’avait été dans une intention libérale, la cour d’appel, qui s’est ainsi justement fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes et qui a considéré que la remise de ces fermages était intervenue à une époque où ceux-ci n’étaient pas prescrits, en a exactement déduit l’existence d’une libéralité rapportable à la succession.
NB – Cette décision fera prochainement l’objet d’un commentaire dans les colonnes de l’AJ famille.
Compétence des juridictions françaises pour statuer sur l’ensemble de la succession du défunt dont la résidence habituelle était située au Royaume-Uni mais qui avait la nationalité française et possédait des biens situés en France (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 19-15.438, 668 FS-B) – Selon l’article 10, § 1, sous a), du Règlement (UE) n° 650/2012 du du 4 juillet 2012, titré « Compétences subsidiaires », lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès. Par son arrêt du 7 avril 2022 (n° C-645/20, rendu sur saisine de la Cour de cassation dans cette affaire le 18 nov. 2020, n° 19-15.438), la CJUE a dit pour droit que ce texte « doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l’article 4 de ce Règlement, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition. »
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur la succession en cause et désigner un mandataire successoral, retient que la résidence habituelle du défunt était située au Royaume-Uni, alors qu’il résultait de ses constatations que le défunt avait la nationalité française et possédait des biens situés en France et qu’elle aurait dû relevé d’office sa compétence subsidiaire.
NB – On rappellera que le Royaume-Uni n’a jamais participé à l’adoption du Règlement (UE) n° 650/2012 du du 4 juillet 2012 et n’a jamais été lié par celui-ci ni soumis à son application.
Pour un commentaire de l’arrêt de la CJUE, v. F. Mélin, D. actu. 14 avr. 2022.

Commentaires récents